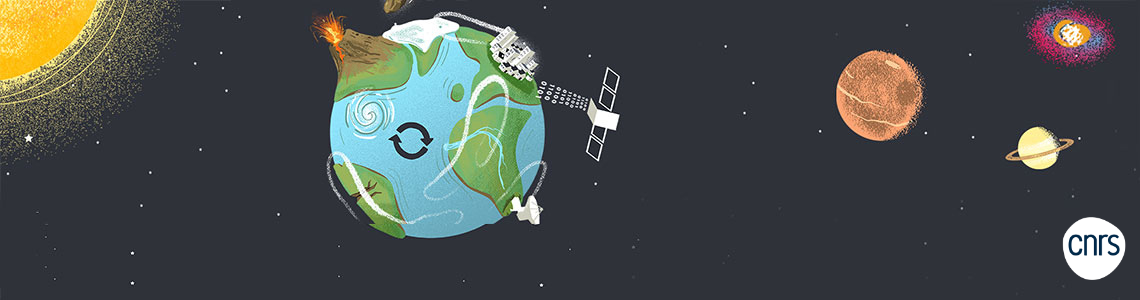Les traces de vie de la limite Ediacarien-Cambrien dans le Massif Armoricain
Résumé
L’origine de la vie est une problématique fondamentale, tant
pour les paléontologues que pour les biologistes. Au sein de ce
vaste questionnement sur la vie primitive, l’émergence des métazoaires
à l’Ediacarien (635-541 Millions d’années) constitue un
moment-clé qui n’est qu’assez peu documenté dans le registre
fossile. Les gisements fossilifères les plus remarquables et les plus
étudiés sont situés en Australie, en Afrique du Sud, au Canada
ou en Chine, mais à ce jour peu de données de terrain ont été
acquises en Europe et encore moins à l’échelle ouest-européenne.
Pourtant, potentiellement, la Bretagne et la Normandie constituent
un cadre géologique optimal pour y découvrir et y analyser
la faune et la microflore édiacariennes. En effet, le Massif Armoricain
présente de larges affleurements de Briovérien (stratotype à
Saint-Lô), un ensemble de couches sédimentaires marines (-667
à -540 Ma), peu ou pas métamorphisées, qui couvre l’intervalle
temporel Ediacarien-Cambrien basal. Qui plus est, bien que réputé
azoïque, le Briovérien supérieur (-584 à -540 Ma) présente localement
des dépôts fossilifères. Les fossiles les plus fréquents sont
de deux types : (1) des pistes ou terriers horizontaux et filiformes,
attestant des activités de métazoaires vermiformes, ces fossiles
ayant été dénommés Montfortia filiformis par Lebesconte à la
fin du XIXème siècle, car provenant de Montfort-sur-Meu (Côtes
d’Armor) ; (2) des surfaces ridées (voire annelées), d’extensions
et de formes variables, considérées tout à tour comme des métazoaires
(verts plats ?, médusoïdes ?) ou des mattes microbiennes,
et baptisées Neantia rhedonensis par Lebesconte, car provenant
de Néant-sur-Yvel (Côtes d’Armor).
Les collections historiques de l’UMR 6118 de Rennes et du
Muséum de Nantes, issues des récoltes de Lebesconte à la fin
du XIXème, et la prospection de nouveaux gisements par les
paléontologues rennais, ont permis de réaliser une synthèse actualisée
des fossiles du Briovérien. Pour l’essentiel, il s’agit de
mattes microbiennes (Neantia) et d’ichnofossiles (Helminthoidichnites,
Helminthopsis, Palaeophycus, Planolites, Spirodesmos, ...),
mais des découvertes récentes témoignent de la préservation
d’organismes de tailles diverses (algues Chuaria, annélides indét.,
médusoïdes indét., incertae sedis, ...).
Les datations de deux sites fossilifères, distants de 30 kms, sont
congruentes avec pour cortège de zircons le plus récent un âge de
550 Ma, donc plutôt Ediacarien (la base du Cambrien étant fixée
à -541 Ma).