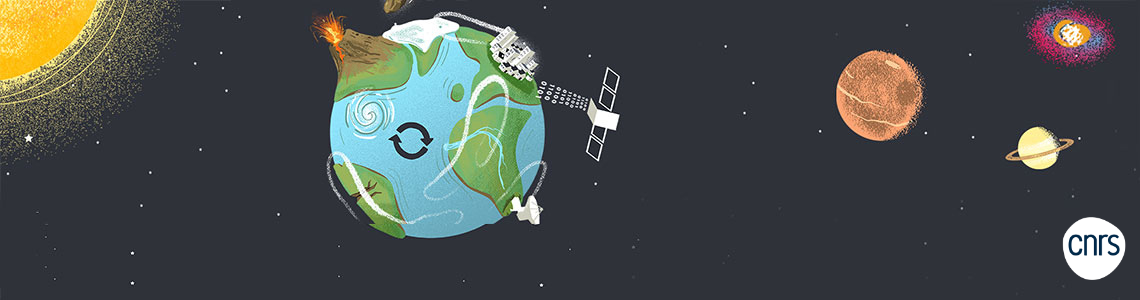Le système Capbreton-Santander : illustration des processus sédimentaires actifs dans les canyons modernes depuis 15 000 ans
Résumé
Le canyon de Capbreton se singularise des autres canyons du Golfe de
Gascogne par sa proximité à la côte. La tête du canyon s’initie dès 30
mètres d’eau et donne naissance à un thalweg sinueux encaissé dans un
canyon étroit aux flancs raides. Le thalweg de Capbreton s’étend sur
plus de 270 km jusqu’à 3 000 mètres de profondeur où il connaît un
brusque changement de direction vers le Nord pour se prolonger dans le
canyon de Santander. A cette profondeur, le canyon de Santander présente
une morphologie en U, plus large et moins haute que le canyon de
Capbreton, illustrant la transition entre canyon profondément incisé et
chenal profond.
En parallèle de cette évolution morphologique, les différents carottages
réalisés dans ces canyons illustrent une évolution de la dynamique sédimentaire
depuis l’amont du canyon de Capbreton jusqu’à la terminaison
du canyon de Santander.
A 80 km de la tête du canyon de Capbreton, perpendiculaire au thalweg,
un transect de quatre carottes illustre les différents processus en action
dans le canyon sur une même verticale : (1) une sédimentation gravitaire
en masse au c ?ur du thalweg, (2) des évènements turbiditiques fins
sur les terrasses basses (< 200 m par rapport au thalweg), à une fréquence
moyenne d’une turbidite/an lors des derniers 2 000 ans et (3) de
la décantation liée aux nuages néphéloïdes, alimentés par les panaches
turbides sur les terrasses hautes (> 200 m). Dans la terminaison du canyon
de Santander, prélevée le long d’un méandre considéré jusqu’alors
abandonné, une carotte montre 8 m de dépôts turbiditiques sableux dont
l’analyse stratigraphique indique une alimentation continue au cours des
derniers 15 000 ans, mais avec des taux de sédimentation holocènes 6
fois plus faibles que sur les terrasses du canyon de Capbreton.
Ainsi même si le canyon de Capbreton, et plus particulièrement ses terrasses,
fonctionnent comme de véritables pièges à sédiments régionaux,
une part non négligeable de ses apports sédimentaires atteint tout de
même les grands fonds à l’Holocène, ce qui est tout à fait singulier en
comparaison des autres grands canyons du Golfe de Gascogne